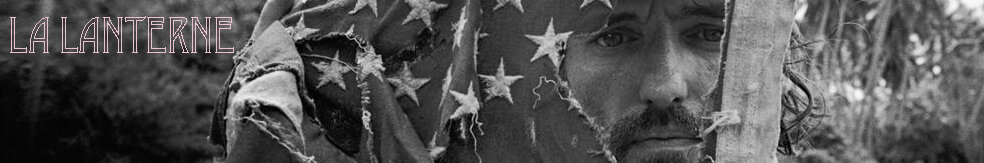Le Poison (Billy Wilder, 1945)
 Le Poison (The Lost Weekend), quatrième film réalisé par Billy Wilder à Hollywood, assied définitivement le statut du cinéaste après la réussite déjà remarquée d’Assurance sur la mort un an plus tôt. La 18e cérémonie des Oscar en atteste : le film repart avec la plupart des récompenses majeures (Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario adapté). Pourtant, aujourd’hui Le Poison est quelque peu oublié, le nom de Wilder étant plus naturellement associé à d’autres titres parmi lesquels Sunset Boulevard, Certains l’aiment chaud, La Garçonnière ou encore La Vie privée de Sherlock Holmes.
Le Poison (The Lost Weekend), quatrième film réalisé par Billy Wilder à Hollywood, assied définitivement le statut du cinéaste après la réussite déjà remarquée d’Assurance sur la mort un an plus tôt. La 18e cérémonie des Oscar en atteste : le film repart avec la plupart des récompenses majeures (Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario adapté). Pourtant, aujourd’hui Le Poison est quelque peu oublié, le nom de Wilder étant plus naturellement associé à d’autres titres parmi lesquels Sunset Boulevard, Certains l’aiment chaud, La Garçonnière ou encore La Vie privée de Sherlock Holmes.
Don Birman (Ray Milland) est romancier et alcoolique de longue date. Sur le point de partir pour un week-end de sevrage avec son frère Wick (Phillip Terry), il use d’un subterfuge pour gagner du temps, trouver de l’argent et aller boire en douce quelques verres au troquet le plus proche. Il confie au barman son histoire : trois ans auparavant, sa rencontre avec Helen St. James (Jane Wyman) l’avait tant envouté qu’il pensait pouvoir guérir de son addiction. Mais ses démons l’ont rattrapé et Don ne parvient plus à écrire, de même qu’il n’arrive pas à affronter son problème de dépendance à l’alcool.
 Comme tout film de Wilder, The Lost Weekend témoigne d’une trame tout à la fois audacieuse et limpide, ponctuée de dialogues absolument remarquables. On devine que le traitement frontal de l’alcoolisme fut perçu à l’époque comme la grande idée du film, car si le thème n’était pas véritablement tabou à Hollywood, il n’avait jamais été véritablement au cœur même d’une histoire. La performance de Ray Milland et les choix de mise en scène de Wilder (qui tourna quelques scènes en décors réels) confèrent une dimension relativement réaliste au film. Néanmoins, Wilder ne va pas complètement au bout de son idée, ce qui explique sans doute la difficulté du film à figurer parmi les plus grandes réussites de son auteur.
Comme tout film de Wilder, The Lost Weekend témoigne d’une trame tout à la fois audacieuse et limpide, ponctuée de dialogues absolument remarquables. On devine que le traitement frontal de l’alcoolisme fut perçu à l’époque comme la grande idée du film, car si le thème n’était pas véritablement tabou à Hollywood, il n’avait jamais été véritablement au cœur même d’une histoire. La performance de Ray Milland et les choix de mise en scène de Wilder (qui tourna quelques scènes en décors réels) confèrent une dimension relativement réaliste au film. Néanmoins, Wilder ne va pas complètement au bout de son idée, ce qui explique sans doute la difficulté du film à figurer parmi les plus grandes réussites de son auteur.
Le défaut principal vient du ton du film qui peine à s’établir. On passe de moments très graves (les scènes de manques du héros, la réduction au vol) à des scènes plus légères (les acrobaties rhétoriques au bar, la blague sur les fermetures arrangées des usuriers juifs et irlandais) pour conclure finalement sur un happy end assez insolite. Le thème de l’alcool ressort finalement comme un simple prétexte au cœur d’un scénario trop bien huilé et peine aujourd’hui à être complètement pris au sérieux. La scène d’hallucination du héros où il voit une chauve-souris dévorer un rat sur le mur de son appartement lève définitivement le voile sur la naïveté un peu navrante des auteurs vis-à-vis du sujet, qui perd sérieusement de sa crédibilité à ce moment précis.
 Le film est donc passablement convaincant sur bien des points. Néanmoins, on peut s’assurer qu’il fut une inspiration importante pour deux œuvres postérieures sur le thème de la dépendance qui elles, ont mieux supporté l’épreuve du temps : tout d’abord L’Homme au bras d’or d’Otto Preminger (1955) où Frank Sinatra joue un musicien camé sérieusement en manque, et Le Jour du vin et des roses, immense film de Blake Edwards (1962) dans lequel on peut voir Jack Lemmon, acteur fétiche de Wilder justement, tout aussi alcoolique et désemparé que Ray Milland, 17 ans plus tôt. Gageons que leur réussite repose sur ce choix que le réalisateur satirique de The Lost Weekend a refusé de faire : plonger à bras le corps dans la tragédie.
Le film est donc passablement convaincant sur bien des points. Néanmoins, on peut s’assurer qu’il fut une inspiration importante pour deux œuvres postérieures sur le thème de la dépendance qui elles, ont mieux supporté l’épreuve du temps : tout d’abord L’Homme au bras d’or d’Otto Preminger (1955) où Frank Sinatra joue un musicien camé sérieusement en manque, et Le Jour du vin et des roses, immense film de Blake Edwards (1962) dans lequel on peut voir Jack Lemmon, acteur fétiche de Wilder justement, tout aussi alcoolique et désemparé que Ray Milland, 17 ans plus tôt. Gageons que leur réussite repose sur ce choix que le réalisateur satirique de The Lost Weekend a refusé de faire : plonger à bras le corps dans la tragédie.